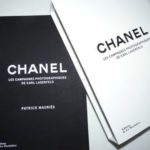Le 6 octobre 2025, sous la verrière du Grand Palais, CHANEL a présenté la première collection de Matthieu Blazy. L’instant a été accueilli par un silence particulier, celui qui précède la véritable émotion. Le lendemain, Paris a parlé d’autre chose qu’un « coup » : d’un retour au vêtement, d’un geste plus que d’un slogan, d’un rythme retrouvé. Voici le récit des échos, sur le moment et au lendemain, d’un défilé qui a fait date.
LE MOMENT SUSPENDU
Il y a des défilés qui se contentent d’illustrer une saison, d’ajouter des pages à l’album des images. Et puis il y a des moments où l’on sent que la mode, soudain, reprend son souffle. Le 6 octobre, au Grand Palais, on n’a pas attendu la dernière silhouette pour comprendre qu’il se passait quelque chose : la salle respirait au même rythme que les vêtements.
Tout commença par une retenue. Une lumière basse, un décor qui semblait lever les yeux vers un ciel peuplé de sphères, un sol noir qui répercutait la marche comme une oscillation, et surtout une première silhouette qui ne cherchait pas le spectaculaire : chemise blanche, pantalon gris, veste boxy légèrement raccourcie. Après des mois d’anticipation et d’hypothèses, cette ouverture avait la netteté d’un trait à l’encre : le vêtement d’abord. À ce moment, la réaction de la salle ne fut pas une ovation prématurée, mais une attention absolue, et une évidence intime : ce serait un défilé de respiration, pas d’esbroufe.
La précision de la coupe, le calme des volumes, la cadence du pas… Le public enregistrait les signes d’un retour à la justesse. Ce n’était pas une continuité par inertie, encore moins une rupture pour la rupture ; c’était une inflexion. Un nouveau point de gravité.
LE TON CHOISI : UNE MODERNITÉ SANS FORFANTERIE
Le même soir, les conversations convergeaient : on parlait de mesure, de modernité tranquille, d’une façon de replacer la couture dans l’ordre des réalités. La chemise, devenue totem dès l’ouverture, résumait cette promesse. Chez Matthieu Blazy, elle n’était pas un geste d’épate, mais une matrice : le point de départ d’une grammaire faite de rythme, d’air, de précision. Le pantalon, fluide sans mollesse, imposait un aplomb ; la veste, taillée juste au-dessus de la hanche, corrigeait la silhouette en un seul mouvement.
Au fil des passages, on voyait le tweed se comporter autrement. On lui avait ôté sa raideur de symbole pour le ramener à sa vérité de matière : lisières effilochées, franges d’air, trames allégées qui accrochaient la lumière. On retrouvait alors ce qui fait la singularité de la Maison lorsqu’elle est elle-même : le tactile avant le décoratif. Le tweed ne tenait plus le vêtement en respect ; il le laissait vivre.
La transparence, leitmotiv assumé, ne jouait ni la provocation ni la facilité. On n’exhibait rien : on orchestrait. Une jupe en organza sur un pantalon droit, une mousseline qui laissait deviner la couture sous-jacente, un voile qui s’ouvrait sur la marche plutôt que sur le regard : la grammaire Blazy n’a pas besoin de souligner, elle insinue. Quant au tailleur noir aux revers ivoire, il réinstallait la rigueur sans rigidité : un pantalon volontairement plus bas, une veste tenue, un débardeur discret qui, d’un seul trait, réconciliait net et moelleux.
LE SOIR MÊME : UN ACCORD PRESQUE UNANIME, SANS COMPLAISANCE
La presse n’a pas attendu le lendemain pour formuler ce que tout le monde éprouvait. Les comptes-rendus qui affluaient dans la nuit ne rivalisaient pas d’hyperbole ; ils parlaient d’intelligence du vêtement, d’un reset créatif. Ce qui frappait, c’était le niveau de cohérence : du décor à la dernière silhouette, tout rimait sans jamais se répéter. La collection n’avait pas l’air d’un patchwork d’idées, mais d’une phrase continue.
Ce consensus, toutefois, n’avait rien d’une bénédiction aveugle. Les esprits les plus sévères soulevaient des questions légitimes : jusqu’où la Maison pourrait-elle pousser ce calme sans perdre l’impact d’une image forte ? Comment traduire, en boutique, ces effilochages qui disent poétiquement l’imperfection et ces superpositions si parfaitement orchestrées au podium ? Il ne s’agissait pas de douter, mais de poser le chantier : une Maison, surtout celle-ci, se juge à la tenue dans la durée.
Reste que le soir, au sortir du Grand Palais, l’ovation finale avait cloué au sol toutes les fausses questions. Elle ne célébrait ni un coup de théâtre, ni un pari marketing, mais la joie simple d’avoir vu juste.
LE LENDEMAIN : L’ANALYSE PREND LE PAS SUR L’ACCLAMATION
Les premières heures du lendemain, Paris s’est réveillé avec un sentiment rare : on avait parlé de couture. Les colonnes s’attardaient sur les coupes, sur les matières, sur la façon. Ce n’était pas l’éternel palmarès des silhouettes « instagrammables » ; c’était le retour des mots qui pèsent : aplomb, main, chute, mouvement, ligne.
Le tweed, encore lui, revenait dans chaque papier, mais à travers des qualificatifs inédits : « aérien », « désarmé », « revivifié ». La chemise obtenait un statut qu’on croyait réservé à la petite veste : sorte de pivot autour duquel tout s’organise, l’objet par lequel on mesure le sérieux d’une Maison.
Quant aux accessoires, ils avaient brusquement cessé d’être des fétiches figés pour devenir des compagnons de langage. Les sacs « crushed », volontairement cabossés, « flaps » entrouverts, coutures apparentes, au métal parfois patiné, ne racontaient pas une dégradation : ils racontaient une vie. C’était un geste subtil, presque pédagogique : rappeler que l’iconique a d’abord été une idée, et non un reliquaire.
L’une des vertus du lendemain est d’autoriser des lectures moins immédiates. On commença à relire la collection à la lumière de l’ADN CHANEL : la liberté du corps de Gabrielle (et non un féminisme de pose) ; la discipline du tailleur (et non une autorité sèche) ; la modernité comme économie du geste (et non comme effet de manche). Cette conversation silencieuse avec la fondatrice, évoquée par certains, donnait un horizon : inventer la continuité.
LES PIÈCES QUI S’IMPOSENT DANS LA MÉMOIRE
Chaque défilé offre, au-delà du flux, des arrêts sur images qui s’accrochent au regard. Le lendemain, tout le monde parlait d’une poignée de silhouettes devenues des signets visuels.
D’abord, le costume d’ouverture, parce qu’il avait donné le ton : une modernité qui ne renverse rien, mais réaccorde. Puis ces silhouettes androgynes où la chemise prend toute la place, non pour gommer le féminin, mais pour lui offrir une aisance nouvelle. Venaient ensuite ces ensembles en tweed effiloché dont les bordures brutes, loin d’un effet « usure », gagnaient en poésie : l’imperfection assumée, au lieu de fragiliser, rendait le vêtement plus vivant.
On citait souvent la jupe diaphane posée sur un pantalon droit : de face, on regardait la ligne ; de profil, on voyait le halo. Un paradoxe délicieux : ce qu’on a trop longtemps nommé « transparence » n’exhibait rien, elle « soignait la pudeur ». Enfin, la robe noire brodée d’épis de blé s’imposait comme un pont évident entre terre et ciel : la main des ateliers, la mémoire de Gabrielle Chanel et la lueur nocturne d’un champ d’été, réunies en un seul vêtement.
Le final continuait, lui aussi, de vivre dans les esprits : ce t-shirt de soie et cette jupe au volume de pétales et de plumes ; non pas l’ultime démonstration, mais la façon la plus simple de dire la couture : une matière qui bouge.
POURQUOI CE DÉFILÉ A TOUCHÉ JUSTE
Il y a, dans ce qui s’est passé, une raison moins visible que les lisières effilochées ou les chaînes souples : le tempo. Le défilé a imposé un rythme : phrases longues, silences utiles, suspensions, reprises. C’est cela, la couture quand elle se souvient d’elle-même : un art du temps. Ce tempo autorise la nuance, installe la confiance, donne la mesure d’une vision.
Dans l’instantanéité saturée des réseaux, où tout doit s’expliquer et s’épuiser en trente secondes, cette lenteur apparente produit un effet rare : elle dure. C’est sans doute ce qui explique que, le lendemain, au lieu de commenter un « moment » ou une « photo », on commentait une langue. Et une langue, dans une Maison comme CHANEL, n’est jamais l’affaire d’une seule saison.
LA MODE AU-DELÀ DU PODIUM : LE VÊTEMENT COMME PROMESSE
Parmi les arguments les plus récurrents du lendemain, il y avait cette idée : la promesse. Non pas la promesse de « faire parler » ou de « faire vendre » (même si cela compte), mais la promesse de porter. Beaucoup de silhouettes semblaient habitables : chemises impeccables, pantalons fluides, tailleurs assouplis, robes qui tiennent, sans contraindre. On ne sortait pas de la salle avec la sensation d’avoir vu une démonstration, mais avec l’envie de marcher.
C’est, à sa manière, le plus bel hommage à Gabrielle Chanel : le vêtement comme compagnon d’existence, qui accompagne le corps au lieu de le faire plier. En ce sens, les sacs « crushed » portaient, eux aussi, un message simple : la beauté n’est pas l’asepsie ; elle est l’usage. On pressent, dès lors, la ligne de force des prochains mois : une diffusion raisonnée de ce vocabulaire dans les collections, les accessoires, le prêt-à-porter, sans renoncer à l’exigence des ateliers.
CE QU’ON RETIENDRA
On se souviendra que, ce soir-là, CHANEL n’a pas crié pour qu’on l’entende. La Maison a parlé bas pour qu’on l’écoute. On se souviendra de la chemise immaculée qui a remplacé la déflagration attendue, du tweed rendu à la vie, des voiles qui ont appris à retenir plutôt qu’à montrer, d’un tailleur qui a choisi la souplesse pour mieux tenir la ligne.
On se souviendra aussi que la salle s’est levée d’un même geste. Et cette ovation, par-delà l’émotion, reconnaissait surtout le travail. Un travail de coupe, de main, de studio et d’atelier, qui ne fait pas du vêtement un alibi pour les images, mais le sujet des images.
Mention obligatoire : © espritdegabrielle.com
Crédits photos : © CHANEL
En savoir plus au sujet MODE
CHANEL RETROUVE BIARRITZ POUR LA CROISÈRE 2026/27
CHANEL présentera sa prochaine collection Croisière 2026/27 à Biarritz, le mardi 28 avril 2026. L’annonce, sobre mais symboliquement puissante, a été …
LA COLLECTION CHANEL CROISIÈRE 2025/26 ARRIVE EN BOUTIQUE
La campagne Croisière 2025/26 s’ouvre comme une séquence de cinéma. La lumière glisse sur le lac de Côme. La Villa …
VANESSA PARADIS AUX NRJ MUSIC AWARDS : UN APPARITION SOBRE, MUSICALE ET PROFONDÉMENT CHANEL
Le vendredi 31 octobre 2025, Vanessa Paradis est montée sur la scène des NRJ Music Awards au Palais des Festivals …